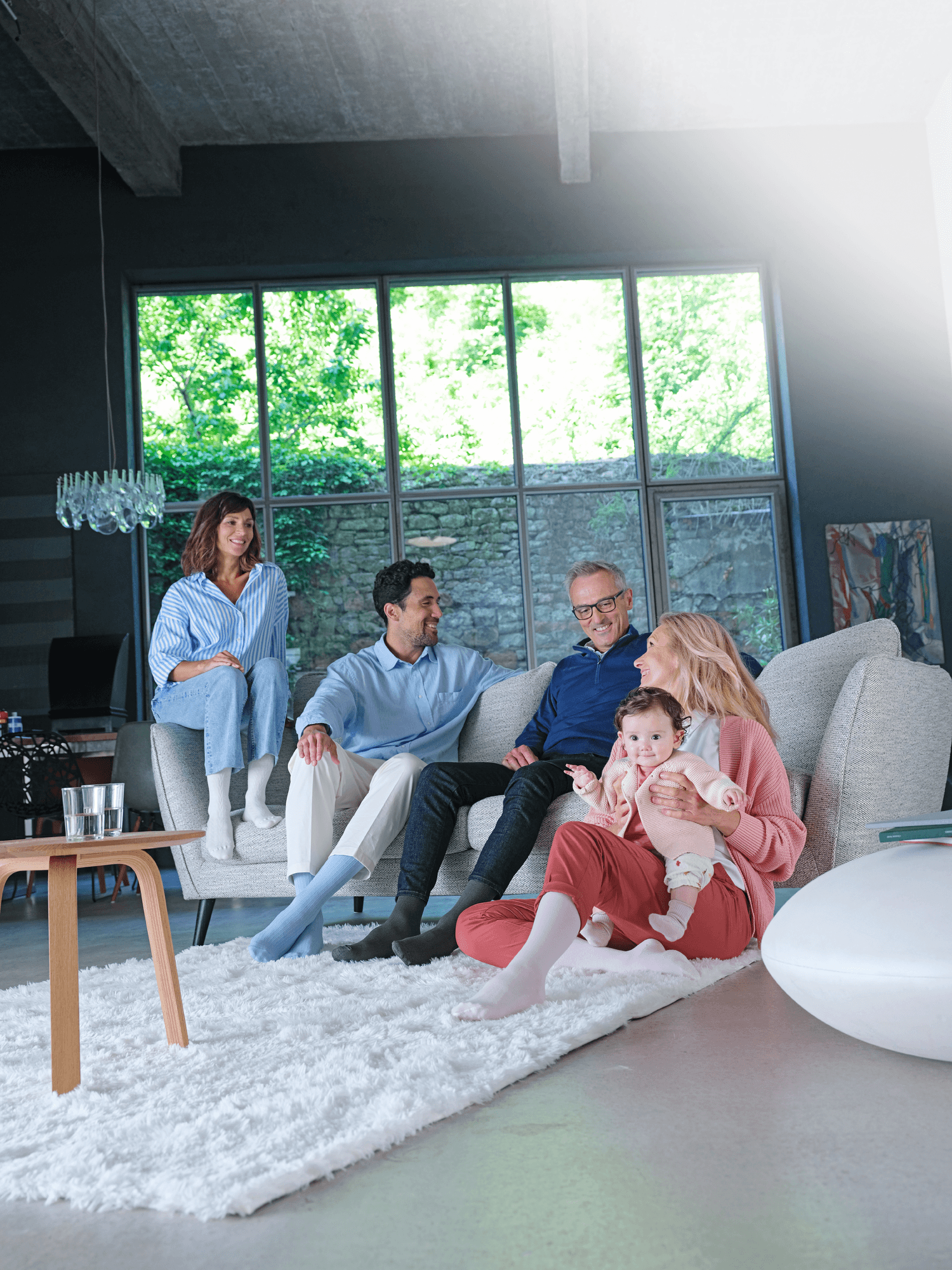Quelle contraception privilégier dans l’insuffisance veineuse ?
Le fait est qu’une contraception mal adaptée peut aggraver la maladie veineuse chez la femme. Une réalité qui n’a rien de vraiment surprenant puisque les pilules contraceptives sont à base d’oestroprogestatifs, différemment dosés selon la « génération » et la marque. Aussi s’agit-il d’être à l’écoute de son corps, pour déterminer si sa pilule accentue ses lourdeurs de jambes, et dès lors adopter en collaboration avec son médecin ou gynécologue le contraceptif le mieux adapté à sa situation.
La principale raison expliquant la disparité entre hommes et femmes quant à la maladie veineuse est de nature hormonale, puisque les hormones féminines ont un effet direct sur les vaisseaux sanguins. Ainsi la progestérone et les œstrogènes, fabriqués naturellement par l’organisme ou apportés par les contraceptifs oraux, sont impliqués dans la sensation de jambes lourdes et l’apparition de varices. Le risque absolu de thrombose veineuse avec l’usage de tous types de contraceptifs oraux combinés chez les jeunes femmes est toutefois inférieur à 1/1000 chaque année.
Pilules de génération 1,2,3… quelles différences ? Et quels risques associés ?
Selon le progestatif utilisé, la plupart des contraceptifs oraux oestroprogestatifs ont été divisés en trois classes ou « générations », appellation qui laisserait entendre que les plus récents sont préférables aux précédents, sans que ce soit avéré. Ces trois générations utilisent le même oestrogène, l’éthinyl-estradiol, à des doses variées, associé à un progestatif norstéroïdien, mais cette classification ne préjuge en rien des avantages ou inconvénients d’une génération par rapport aux autres. A noter que les pilules de première et seconde générations sont remboursées, alors que celles de troisième génération ne le sont pas.
Quelles sont les recommandations officielles ?
Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé publiées en 2013, trois cas sont à distinguer :
- Chez les femmes présentant des varices ou une thrombophlébite superficielle, le risque de thromboembolie veineuse n’est pas augmenté et toute méthode de contraception peut être utilisée. Un antécédent personnel de thrombose veineuse superficielle ne représente pas une contre-indication aux contraceptions hormonales dans leur ensemble.
- Chez les femmes aux antécédents de maladie veineuse (embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde), la contraception progestative peut être utilisée (sauf la contraception progestative injectable). Cependant par précaution, elle est contre-indiquée en cas de thrombose en cours et doit être arrêtée si un accident thromboembolique veineux survient pour la 1ere fois au cours de son utilisation. L’examen préalable des antécédents personnels ou même familiaux de thrombose veineuse profonde ou d’une embolie pulmonaire, est nécessaire et un bilan d’hémostase pourrait être utile avant la prescription d’une contraception hormonale.
- Si la thrombophilie est avérée, la contraception oestroprogestative par voie orale ou non orale est définitivement contre-indiquée. Dans ces situations, à distance de l’épisode aigu (thrombose veineuse, embolie pulmonaire), il est possible d’utiliser un microprogestatif ou un progestatif macrodosé.
A noter que l’utilisation des moyens de contraception dit « mécaniques » comme les préservatifs, diaphragme ou les spermicides, demeure possible en cas d’insuffisance veineuse.
Tour d’horizon des autres solutions contraceptives
Si une pilule à base d’hormones est la plus communément utilisée pour se protéger contre une grossesse non désirée, il existe de nombreux autres moyens contraceptifs, qui peuvent d’ailleurs être combinés entre eux de sorte à procurer la meilleure efficacité.
Parmi ceux-ci citons : les implants, qui sont glissés en sous cutané dans le bras pour une libération continue dans le sang(1), les « stérilets », hormonal ou au cuivre(2), les progestatifs injectables(3), les « anneaux » permettant une libération hormonale directement dans la cavité utérine(4), les patchs(5), les diaphragmes et capes cervicales(6), les spermicides, sous forme de crèmes ou gels(7), la stérilisation, féminine ou masculine(8) ou encore les préservatifs féminins et masculins(9) qui présentent également l’avantage de protéger des maladies sexuellement transmissibles.
- L’implant est un petit bâtonnet cylindrique, en plastique, de 4 cm de long et 2 mm de diamètre (la taille d’une allumette), contenant les mêmes hormones que les pilules progestatives. Une fois mis en place, les hormones qu’il contient diffusent directement dans la circulation sanguine et suppriment l’ovulation.
- Improprement appelé « stérilet » – puisqu’il ne rend pas stérile -, le DIU ou « dispositif intra-utérin » est un moyen de contraception inséré dans l’utérus par un professionnel de santé.
- Il s’agit d’un progestatif de synthèse (médroxyprogestérone) injecté par piqûre intramusculaire tous les trois mois, et qui assure pendant ce laps de temps une contraception constante.
- L’anneau vaginal inséré au fond du vagin est un dispositif flexible en plastique poreux contenant une association d’hormones (oestrogène et progestatif), qui à la chaleur du corps diffusent à travers la paroi vaginale et passent dans le sang.
- Le patch contraceptif est un timbre qui se colle sur la peau et qui diffuse deux hormones (l’estradiol et le progestatif) dans le sang à travers la peau.
- Le diaphragme (en latex ou en silicone) et la cape cervicale (en silicone) se glissent dans le vagin, au contact du col de l’utérus, pour empêcher le passage des spermatozoïdes vers l’intérieur de l’utérus.
- Les spermicides sont des substances qui, comme leur nom l’indique, rendent inactifs ou détruisent les spermatozoïdes.
- La stérilisation à visée contraceptive concerne les femmes (ligature des trompes et hystéroscopie) et les hommes (vasectomie) qui souhaitent, de manière définitive, ne pas avoir d’enfant.
- Les préservatifs masculins (extérieur) comme féminin (intérieur, positionné dans le vagin) empêchent le passage des spermatozoïdes dans le vagin, et donc la fécondation.
Pour toute autre question, demandez conseil à votre médecin.
- Øjvind Lidegaard et al., Hormonal contraception and risk of venous thromboembolism: national follow-up study; BMJ; 2009;339:b2890
- HAS : contraception chez la femme à risque cardiovasculaire
- Revue médicale Suisse : quelle contraception pour la femme à risque de maladie thromboembolique veineuse ?
- choisirsacontraception.fr
Article publié le 25 août 2016 par Nathaly Mermet, journaliste scientifique et médicale.